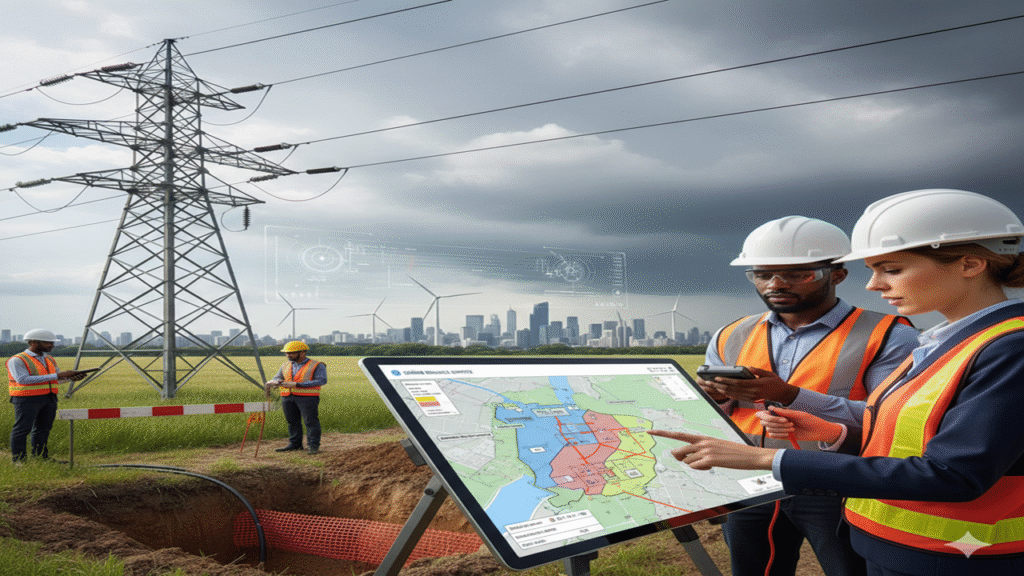Introduction :Réseaux de Distribution Électrique
Le réseau de distribution électrique est l’infrastructure critique qui assure le transport de l’énergie des postes de répartition jusqu’aux consommateurs finaux. Invisible pour la majorité des utilisateurs, il représente pourtant l’épine dorsale de l’activité économique et du confort quotidien. Cependant, sa performance est constamment mise à l’épreuve par des contraintes multiples : la surcharge, les phénomènes climatiques extrêmes (foudre, tempêtes, givre), les défauts d’équipement, et même les manœuvres d’exploitation.
En 2025, l’impératif de fournir une énergie non seulement disponible, mais de haute qualité, est plus pressant que jamais. Le dimensionnement et l’exploitation des réseaux ne sont plus de simples tâches d’ingénierie, mais des disciplines rigoureusement encadrées par une réglementation technique dont le respect est la garantie de la sécurité des biens et des personnes, de la continuité de service et de l’efficacité économique.
Cet article propose une immersion complète dans le monde de la réglementation technique des réseaux de distribution (MT/BT), en détaillant les principes fondamentaux de la conception, du dimensionnement (électrique et mécanique), des exigences de sécurité et des stratégies d’optimisation face aux défis de la transition énergétique. Nous explorerons comment les choix topologiques, les normes de construction et les évolutions technologiques façonnent la fiabilité et la performance des infrastructures électriques.
Table of Contents : Distribution Électrique
Partie 1 : Les Fondamentaux du Distributeur et l’Impératif de Qualité de Service des Réseaux de Distribution Électrique
Le Rôle et les Objectifs du Distribution Électrique
La raison d’être fondamentale de tout distributeur d’énergie électrique est de fournir de l’énergie électrique aux consommateurs. Cette mission englobe des objectifs multiples et souvent interdépendants:
- La Continuité et la Qualité de Service : Réduire le nombre et la durée des coupures d’alimentation et éviter les perturbations (fluctuations de tension et de fréquence).
- La Sécurité : Assurer la sécurité des biens et des personnes à tout moment.
- L’Exploitation : Garantir la souplesse et le confort d’exploitation des ouvrages.
- La Compétitivité : Maintenir une compétitivité commerciale pour le produit fourni.
L’évolution actuelle pousse les distributeurs à se concentrer sur la qualité de l’énergie livrée, notamment en réduisant le nombre de défauts fugitifs, qui sont particulièrement gênants pour les utilisateurs industriels.
Analyse des Défauts et Classification des Réseaux de Distribution Électrique
Les incidents et pannes sur les réseaux de distribution peuvent être provoqués par des surcharges, la foudre, le claquage d’un équipement, des orages violents, des glissements de terrain, ou des erreurs de manœuvre. Comprendre la nature des défauts est essentiel pour choisir les stratégies d’atténuation.
| Type de Défaut | Durée | Conséquence typique | Prédominance |
| Fugitif | Coupure brève (de l’ordre de 100 ms). | Généralement liée au temps de fonctionnement d’un réenclencheur. | Très majoritaire sur les réseaux aériens. |
| Permanent | Coupure longue (quelques minutes à quelques heures). | Nécessite une intervention humaine pour être résolu. | Majoritaire sur les réseaux souterrains. |
Les réseaux aériens, étant plus exposés aux éléments (branches d’arbre, foudre, vent, neige, vandalisme), nécessitent des solutions de protection spécifiques. Le besoin constant d’améliorer la performance et la fiabilité est soutenu par des études statistiques qui visent à classifier les incidents, déterminer leurs causes et évaluer comparativement les performances des différentes topologies. La performance du réseau, mesurée par des critères comme le degré d’indisponibilité (temps cumulé annuel durant lequel un client est privé d’électricité) , dépend fondamentalement de sa topologie.
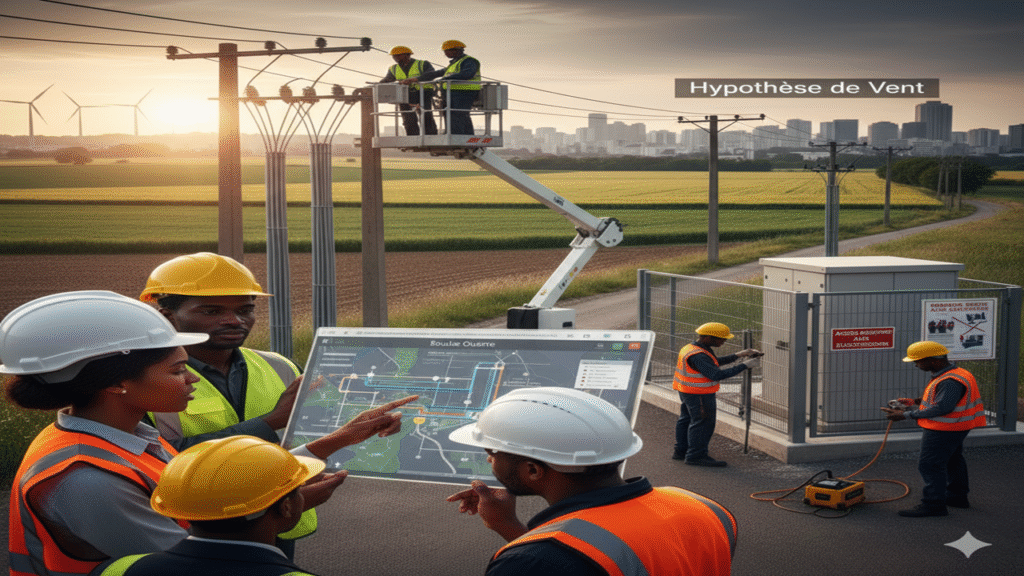
Partie 2 : La Topologie des Réseaux Distribution Électrique: Architecturer la Fiabilité
La topologie d’un réseau électrique définit l’ensemble des principes structuraux mis en œuvre pour acheminer l’énergie en distribution publique. Le choix de la topologie est le résultat d’un arbitrage délicat entre des impératifs techniques et économiques.
Critères et Éléments de Choix Topologique pour les reseaux Distribution Électrique
Le choix d’une topologie est influencé par des facteurs socio-géographiques et techniques:
- Densité de Charge : L’un des facteurs les plus importants. Exprimée en MVA/Km², elle permet de distinguer les zones à faible densité (≤1 MVA/Km2) des zones à forte densité (≥5 MVA/Km2).
- Contraintes Environnementales : L’étendue géographique, le relief, les difficultés de construction, et les conditions climatiques (température, fréquence des orages, neige).
Une fois la topologie choisie, elle fixe des éléments clés de la conception:
- Tension de service : Par exemple, 22 kV au Maroc, 6,6 kV au Japon, ou 11 kV/33 kV en Grande-Bretagne. Le choix est un compromis entre les coûts de réalisation et d’exploitation du réseau.
- Courant de défaut à la terre : Fixé pour le réseau (ex : 300 A en aérien et 1000 A en souterrain). Ce choix a des répercussions directes sur la tenue des matériels.
- Type de distribution :
- Milieu urbain à forte densité ⟹ Distribution souterraine.
- Milieu rural à faible densité ⟹ Distribution aérienne.
- Mode d’exploitation : Manuel, automatique ou téléconduit.
Les Schémas de Réseaux MT de Base
Pour les réseaux MT, qui sont particulièrement longs (environ 90 000 km au Maroc) , les distributeurs s’appuient principalement sur deux topologies de base : le Radial et le Boucle Ouverte.
1. Le Schéma Radial (ou en Antenne)
- Principe de Fonctionnement : Alimentation par une seule voie. Tout point de consommation ne peut être alimenté que par un seul chemin électrique.
- Structure : De type arborescent, partant des postes de distribution publique (HT/MT ou MT/MT).
- Application : Typiquement utilisé pour la distribution MT en milieu rural. Il permet d’accéder à des points de consommation à faible densité de charge (≈10 KVA/Km2) à moindre coût. Il est très souvent associé à une distribution de type aérien.
- Avantages/Inconvénients : Simple et peu coûteux à l’installation, mais offre une qualité de service plus faible.
2. Le Schéma Boucle Ouverte (ou Coupure d’Artère)
- Principe de Fonctionnement : Alimentation par deux voies possibles, mais avec un point d’ouverture permanent dans la boucle. Il fonctionne comme deux antennes. En cas de défaut, le secours est assuré par la possibilité de bouclage.
- Structure : Une boucle sur laquelle sont connectés les points de consommation (postes MT/BT ou postes de livraison). Chaque point est raccordé par deux interrupteurs MT.
- Application : Typiquement utilisé en milieu urbain à forte densité, souvent associé à une distribution de type souterraine.
- Avantages/Inconvénients : Bonne qualité de service, mais implique des manœuvres plus nombreuses lors de l’exploitation et des coûts d’installation plus élevés.
3. Le Schéma Double Dérivation
- Principe de Fonctionnement : Le réseau MT est dédoublé (circuits A et B sous tension). Chaque poste MT/BT est raccordé aux deux câbles mais n’est connecté effectivement qu’à un seul.
- Secours : Un automatisme local détecte l’absence de tension sur le câble défaillant et donne un ordre de permutation automatique. Le temps de permutation (tr) peut varier de 5 à 25 secondes.
- Application : Utilisé dans des zones nécessitant une fiabilité accrue, souvent en souterrain.
L’Appareillage MT : La Commande et la Protection
L’appareillage MT est essentiel pour assurer trois fonctions de base:
- Le Sectionnement : Isoler une partie du réseau pour y travailler en toute sécurité.
- La Commande : Ouvrir ou fermer un circuit dans ses conditions normales d’exploitation.
- La Protection : Isoler une partie du réseau en situation anormale (défaut).
Les deux appareils les plus utilisés sont:
- Le Disjoncteur MT : Sa fonction principale est la protection, il assure également la fonction commande et, selon son type d’installation, le sectionnement.
- L’Interrupteur MT : Sa fonction principale est la commande, il assure également le sectionnement.
Dans le cadre de l’évolution vers le « Smart Grid » en 2025, l’interrupteur est de plus en plus télécommandé, permettant des opérations de reconfiguration rapides sans déplacement de l’exploitant (téléconduite).
Partie 3 : Les Exigences Réglementaires de Sécurité et de Dimensionnement des Réseaux Distribution Électrique hta
Le réseau HTA a pour finalité d’acheminer l’électricité au point de moyenne consommation (postes MT/BT publics ou postes de livraison privés). La réglementation technique est particulièrement dense dans ce domaine.
Sécurité contre les Contacts Directs (Réseau Distribution Électrique HTA Aérien)
La protection contre les contacts directs est assurée par l’éloignement. L’Arrêté Technique impose des distances minimales à respecter, qui tiennent compte:
- L’activité des personnes et les objets manipulés à proximité.
- L’affectation des sols (routes, terres agricoles, forêts).
- La nature des installations au sol (bâtiments, dépôts d’hydrocarbures).
- Le voisinage avec d’autres installations aériennes (lignes BT, télécoms).
Les distances minimales (D) sont le résultat d’une addition complexe:
D=b+t
- b (Distance de base) : Déterminée par des considérations d’encombrement et l’affectation du sol.
- t (Distance de tension) : Fonction de la tension entre phases (U) de la ligne et de la probabilité de voisinage.
Trois cas de probabilité de voisinage sont distingués:
- Probabilité faible : t1=0.0025×U
- Probabilité moyenne : t2=0.0050×U
- Probabilité forte : t3=0.0075×U
Exemples de Distances Minimales aux Sols (pour des portées usuelles):
| Nature du Surplomb | Formule Réglementaire | 22 kV | 60 kV | 400 kV | ||||
| Terrains Ordinaires | b+t1 avec b=6 | 6.00 m | 6.00 m | 7.50 m | ||||
| Terrains Agricoles | b+t2 avec b=6 | 6.00 m | 7.00 m | 8.50 m | ||||
| Voies Normales | b+t3>8 avec b=6 | 8.00 m | 8.50 m | 9.50 m |
Ces distances doivent être vérifiées en l’absence de vent et pour la température de répartition.
Protection et Voisinage ( réseau Distribution Électrique HTA Souterrain)
Contrairement aux réseaux aériens, l’Arrêté Technique est moins prescriptif sur les profondeurs de tranchée et les matériaux, laissant ce soin aux gestionnaires de voirie. Cependant, il fixe des règles cruciales pour la sécurité et la traçabilité:
- Identification et Repérage : Le tracé des canalisations doit être relevé sur un plan tenu à jour.
- Protection et Signalisation : Les câbles doivent être protégés contre le tassement des terres et les chocs d’outils. Un dispositif avertisseur (généralement un grillage de signalisation) conforme aux normes doit être placé au moins à 0.20 meˋtre au-dessus du câble.
- Voisinage des Canalisations : Des distances minimales doivent être respectées pour éviter les dommages lors d’interventions.
- Croisement avec autre canalisation électrique ou télécom : 0.2 meˋtre.
- Parallèle avec câble télécom enterré directement : 0.5 meˋtre.
- Voisinage (avec ou sans croisement) avec conduite d’eau, gaz, etc. : 0.2 meˋtre.
Dimensionnement de réseau Distribution Électrique : La Maîtrise de la Température
Le dimensionnement électrique est basé sur l’Intensité Maximale Admissible en Régime Permanent (IMAP) pour éviter le vieillissement des matériaux et l’augmentation excessive des flèches.
Intensité Maximale et Surcharge
Les règles d’exploitation définissent deux valeurs de courant:
- IMAP : L’intensité où l’équilibre thermique est atteint en régime permanent.
- IS (Intensité maximale de Surcharge Temporaire) : Admissible pour une courte durée (20 à 30 minutes) pour permettre au service de conduite de réduire le courant dans les ouvrages surchargés par des manœuvres appropriées.
La température atteinte par les câbles dépend de l’équilibre entre la puissance apportée (effet Joule et rayonnement solaire) et la puissance dissipée (convection par le vent et rayonnement infrarouge).
Les températures maximales de fonctionnement retenues au Maroc sont:
- HTA (22 kV) : 55∘C
- HTA (60 kV) : 70∘C
Les intensités admissibles sont calculées à partir de températures ambiantes conventionnelles fixées selon les saisons : 30∘C en été, 20∘C en intersaison, et jusqu’à 5∘C pour les courtes périodes d’hiver. Par exemple, pour un câble Almélec de 148 mm2, l’intensité admissible est de 365 A.
La Qualité de Service : Foudre, Pollution et Tenue aux Courts-Circuits
Le dimensionnement électrique ne concerne pas uniquement le régime permanent ; il doit aussi anticiper les situations de défaut.
Foudre et Pollution
- Défauts de Foudre : Deux types d’amorçage sont possibles : les coups directs (défaut d’écran des câbles de garde, souvent monophasé) et les amorçages en retour (lorsque la foudre frappe un pylône, le potentiel du pylône s’élève au-delà de la tenue des chaînes d’isolateurs).
- Pollution des Isolateurs : La pollution (poussières, dépôts salins, chimiques) adhère aux isolants et crée une croûte conductrice permettant l’écoulement d’un faible courant de fuite. Le dimensionnement des chaînes d’isolateurs doit tenir compte du degré de pollution de la zone (Classe 1 à 4) en choisissant une ligne de fuite spécifique minimale.
- Zones rurales (Classe 1) : 16 mm/kV.
- Zones en bordure de mer (Classe 3) : 25 mm/kV.
- Zones très polluantes (Classe 4) : 31 mm/kV.
Tenue aux Courts-Circuits
Les courants de court-circuit sollicitent fortement l’infrastructure:
- Chaines d’isolateurs : Soumis à l’effet de l’arc électrique.
- Conducteurs et Connexions : Subissent des échauffements (phénomène de Joule).
- Efforts Électrodynamiques : Les conducteurs sont soumis à des forces magnétiques importantes.
Mise à la Terre (Prises de Terre)
La mise à la terre des supports métalliques est obligatoire pour la sécurité et la réglementation. Son rôle est de permettre l’écoulement des courants de défaut (foudre ou 50 Hz). Elle doit garantir la sécurité des personnes en limitant les tensions de toucher (entre le pylône et le sol environnant) et les tensions de pas (entre deux points du sol). La résistance de ces prises de terre est généralement de 7 à 10Ω.
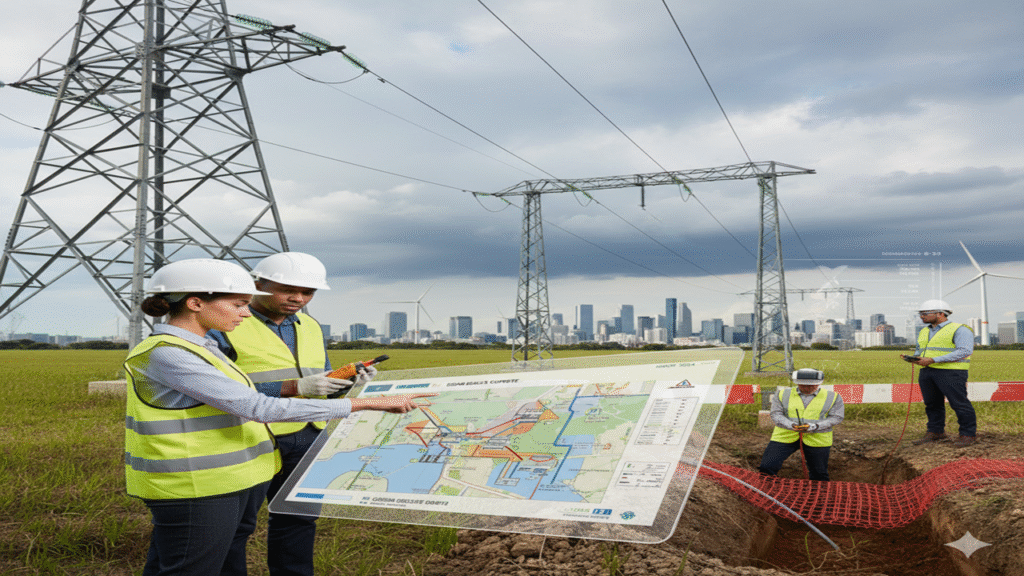
Partie 4 : Dimensionnement Mécanique : L’Endurance des Lignes Aériennes
Le dimensionnement mécanique vise à déterminer la résistance de chaque élément (câbles, supports, fondations) face aux efforts permanents et, surtout, aux efforts occasionnels engendrés par le climat (vent, givre, neige).
Les Hypothèses Climatiques et les Efforts Occasionnels
La réglementation fixe des hypothèses climatiques de référence, et le maître d’œuvre choisit le degré de sévérité (zones de vent, surcharge de givre).
1. Hypothèse de Vent (Hypothèse A)
Elle représente les conditions de tempête. Elle est associée à une température de 25∘C et distingue trois niveaux de sévérité:
- Zone à Vent Normal (ZVN) : La majeure partie du territoire.
- Zone à Vent Fort (ZVF) : Côtes atlantiques et régions montagneuses.
- Zone à Haute Pression de Vent (ZHV) : Pour les grandes portées et les sites très exposés.
La pression de vent peut atteindre 260 Pa (État 1) ou 480 Pa (État 2) sur les câbles.
2. Hypothèse de Température Basse/Vent Faible (Hypothèse B)
Elle est contraignante pour les portées courtes. La température minimale est fixée à 5∘C (État 1) ou −5∘C (État 2), associée à un vent faible de 120 Pa à 180 Pa.
3. Hypothèse de Givre
Elle est critique pour le dimensionnement des ouvrages. La vérification est faite pour une température de −5∘C avec une surcharge uniforme de givre sur les conducteurs.
4. Hypothèses Complémentaires et de Rupture
L’hypothèse de rupture est représentative de la rupture d’un câble ou de l’effort de torsion causé par des charges de givre inégales. Des hypothèses complémentaires sont définies pour les efforts subis par les ouvrages pendant leur construction et leur entretien (levage, poids des monteurs).
La Vérification Mécanique : L’Application du Coefficient de Sécurité
La vérification consiste à s’assurer que l’effort exercé ne dépasse pas l’effort ultime (qui entraînerait la ruine ou des déformations permanentes de l’ouvrage).
Le coefficient de sécurité (K) est le rapport entre cet effort ultime et l’effort conventionnellement exercé. Il permet de tenir compte des incertitudes de calcul et des dispersions dans les caractéristiques des matériaux.
| Élément | Hypothèse de Surcharge | Coefficient de Sécurité K (par rapport à la ruine) | Condition | |
| Câbles et pièces de traction (chaînes d’isolateurs) | Vent, Température | ≥3 | La tension des câbles ne doit pas dépasser ≈2/3 de la charge de rupture. | |
| Supports en Béton (pièces à la flexion) | Vent, Température | ≥2.1 | L’effort ne doit pas dépasser l’effort entraînant des fissurations permanentes. | |
| Supports Métalliques | Vent, Température | ≥1.8 | La contrainte maximale doit être inférieure à la limite élastique du métal. | |
| Givre Uniforme | Givre | ≈1 | L’effort exercé doit être au plus égal à l’effort ultime |
Partie 5 : La Réglementation des Réseaux Distribution Électrique Basse Tension (BT) et les Postes MT/BT
Distribution Électrique Lignes Aériennes Basse Tension (BT)
Les lignes BT sont de plus en plus construites en conducteurs isolés (câble torsadé). Leur réglementation porte sur les mêmes principes de sécurité, mais avec des exigences de distance adaptées à leur niveau de tension.
Distances d’Éloignement
Pour les lignes BT en conducteurs isolés, la distance d’éloignement D est simplement égale à la distance de base b.
| Nature du Surplomb/Voisinage | Distance Minimale D | |
| Terrains Ordinaires ou Agricoles | 5 meˋtres | |
| Voies Ouvertes à la Circulation Publique | 6 meˋtres (portée à 8 m sur autoroute) | |
| Terrains Agricoles avec Engins (hauteur h) | h+1 meˋtres | |
| Arbres et Obstacles Divers | 0 meˋtres (avec précaution contre la détérioration mécanique) | |
| Voisinage/Croisement avec Ligne de Télécommunication | 1 meˋtre (la ligne électrique doit être au-dessus) | |
| Lignes BT et HTA sur Mêmes Supports | 1 meˋtre (avec dispositif avertisseur HTA et isolation BT ≥6000 V) |
Exporter vers Sheets
Conception du Réseau BT Torsadé
Le câble torsadé est la solution privilégiée pour les réseaux BT. Il se compose généralement de trois phases en aluminium, d’un neutre porteur en Almélec, et parfois d’une phase pour l’éclairage public.
- Portée Maximale : 60 m.
- Chute de Tension Maximale : 10% en milieu rural, 7% en zone urbaine.
- Garde au Sol Minimale : 6 m (voies carrossables), 5 m (terres cultivables), 4 m (terrains non cultivables).
- Accessoires : L’utilisation de connecteurs à perforation d’isolant 6 kV (CPI) est la norme pour les branchements et les dérivations, assurant une étanchéité totale et une tenue aux chocs de foudre.
Distribution Électrique Les Postes HTA/BT : Le Cœur de la Distribution Finale
Les postes de transformation (sur poteau ou en cabine – préfabriqué, maçonné ou en immeuble) sont la dernière étape avant la livraison en Basse Tension.
Sécurité dans les Postes
Un poste est un local ou un emplacement d’accès réservé aux électriciens.
- Identification : Des écriteaux très apparents doivent prévenir le public du danger de pénétrer. Une affiche concernant les premiers soins aux électrisés est obligatoire.
- Protection Contre les Contacts Directs : Si la mise hors portée est réalisée par éloignement, la distance minimale entre les conducteurs nus sous tension HTA et le sol est de 2.5 meˋtres.
- Manœuvre : Pour les postes sur poteau, chaque poste ou groupe de postes doit être séparé du réseau par un interrupteur manœuvrable du sol. Une plateforme de manœuvre doit être aménagée au droit du dispositif de manœuvre de l’interrupteur aérien HTA.
- Protection Contre les Surtensions : Les postes alimentés par un réseau HTA en conducteurs nus doivent être protégés par des parafoudres conformes aux normes.
Caractéristiques des Postes MT/BT
Les puissances normalisées varient selon le type de poste:
- Postes Aériens : 25,50,100,160 kVA. Le support doit avoir un effort nominal adapté (1000 daN ou 1500 daN) et une hauteur de 12 m.
- Postes Maçonnés : 250,315,400,630 kVA. La hauteur sous plafond est de 3.70 m (urbain) à 7.70 m (rural).
Distribution Électrique Les Branchements BT
Le branchement BT est la liaison entre le réseau public et le consommateur.
- Isolation : Les branchements aériens doivent être réalisés par des conducteurs isolés.
- Distance au Sol : D=5 meˋtres au-dessus des terrains ordinaires.
- Voisinage des Bâtiments : Les branchements posés sur façades doivent respecter des distances précises:
- 2 meˋtres au moins au-dessus du sol et des terrasses.
- 0.2 meˋtre au moins au-dessus des ouvertures.
- 0.05 meˋtre au moins des parties métalliques extérieures (tuyaux, ossature).
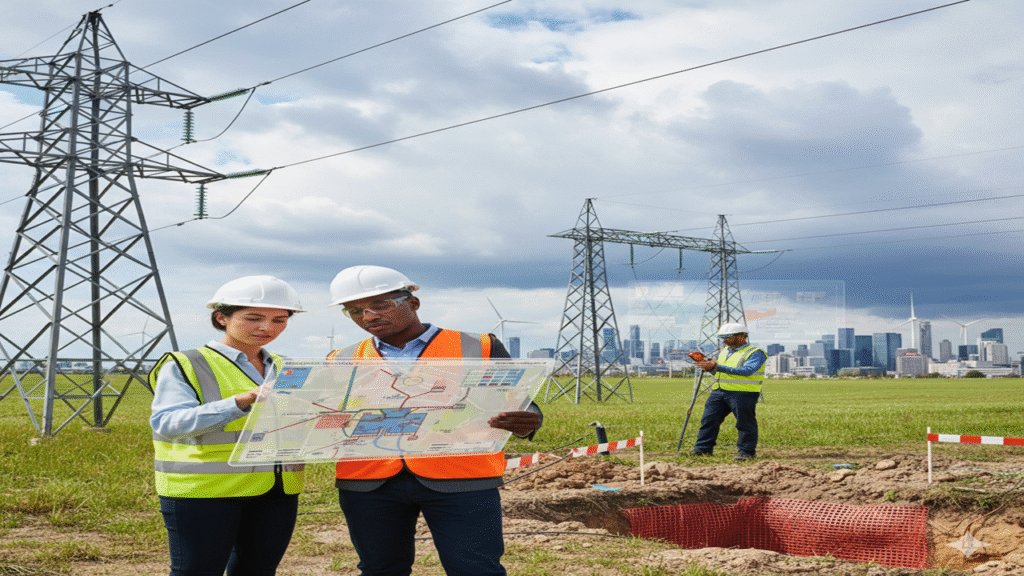
Partie 6 : Tableau Récapitulatif : Distribution Électrique
Le respect de la réglementation technique est un processus structuré qui intègre des choix stratégiques (topologie) et des exigences détaillées de dimensionnement.
| Domaine Clé | Objectif Principal | Stratégies/Exigences Fondamentales | Référence Réglementaire |
| Topologie et Exploitation | Optimiser la qualité de service (continuité et coupures). | Choisir le schéma adapté à la densité de charge : Radial (rural/coût) ou Boucle Ouverte (urbain/qualité). Définir le niveau de tension et le courant de défaut à la terre. Utiliser l’interrupteur télécommandé (téléconduite) pour les reconfigurations rapides. | Partie 1, II-7 |
| Sécurité (HTA Aérien) | Protection contre les contacts directs. | Calculer la distance d’éloignement D=b+t en fonction de la tension et de la probabilité de voisinage. Respecter les distances minimales au sol et aux constructions (ex. : 8 m au-dessus des voies normales). | Arrêté Technique (Art. 12, 24, 25). |
| Dimensionnement Électrique | Assurer la pérennité du matériel et la sécurité de fonctionnement. | Calculer l’Intensité Maximale Admissible (IMAP) en régime permanent, en respectant les températures maximales (55∘C pour 22 kV). Dimensionner la ligne de fuite des isolateurs selon la classe de pollution du site (16 à 31 mm/kV). | Arrêté Technique (Art. 23). |
| Dimensionnement Mécanique | Garantir la tenue des ouvrages aux contraintes climatiques extrêmes. | Utiliser les hypothèses climatiques (Vent A, Température Basse B, Givre). Appliquer des coefficients de sécurité adaptés (ex. : K≥2.1 pour supports béton, K≥3 pour câbles). | Arrêté Technique (Art. 13). |
| Réseaux BT | Garantir la qualité de la distribution finale. | Limiter la chute de tension à 10% (rural) ou 7% (urbain). Utiliser le câble torsadé (max. 60 m de portée) avec la garde au sol réglementaire. | |
| Postes HTA/BT | Protéger les équipements et l’accès public. | Mettre en place des parafoudres si alimenté par ligne nue HTA. Sécuriser l’accès (porte à clef) et respecter la distance de sécurité HTA/sol (2.5 m). | Arrêté Technique (Art. 68, 44). |
Conclusion : Vers des Réseaux de Distribution Électrique plus Résilients et Intelligents
La réglementation technique de réseau deDistribution Électrique n’est pas une simple contrainte administrative ; elle est la fondation sur laquelle repose la fiabilité de l’alimentation électrique. L’approche marocaine, formalisée par l’Arrêté Technique et les documents internes (CPCT, Directives) , s’appuie sur une analyse exhaustive des risques (électriques, mécaniques, climatiques) pour garantir le dimensionnement adéquat des ouvrages.
En 2025, la résilience du réseau face aux aléas climatiques amplifiés (nécessitant des efforts constants sur l’hypothèse givre, vent et température) et l’intégration croissante des énergies renouvelables distribuées sont les défis majeurs. L’évolution vers des systèmes de téléconduite performants, l’optimisation des topologies pour une meilleure qualité de service et le respect rigoureux des normes de sécurité (mise à la terre, éloignement, protection) restent les priorités absolues des distributeurs. La qualité de service, quantifiée et mesurée, est la boussole guidant les investissements futurs, assurant que l’électron parvient au consommateur dans les meilleures conditions de continuité et de sécurité.
FAQ: Distribution Électrique
1. Quelle est la différence fondamentale en matière de défauts entre un réseau HTA aérien et un réseau HTA souterrain ?
La nature des défauts est différente : sur les réseaux aériens, les défauts sont majoritairement fugitifs (coupures brèves de l’ordre de 100 ms), souvent dus à des causes externes comme la foudre ou des branches d’arbre. Sur les réseaux souterrains, les défauts sont majoritairement permanents (coupures longues nécessitant une intervention humaine).
2. Comment la réglementation détermine-t-elle la distance minimale entre un conducteur HTA et le sol ?
La distance minimale (D) est calculée par la somme de deux composantes : une distance de base (b), déterminée par l’encombrement et l’affectation du sol (ex. : b=6 mètres pour terrains ordinaires) , et une distance de tension (t), fonction de la tension entre phases (U) et de la probabilité de voisinage. La formule est D=b+t.
3. Quel est l’impact de la pollution sur le dimensionnement des lignes électriques HTA ?
La pollution de l’air (dépôts salins, industriels, poussières) peut former une croûte sur les isolateurs, permettant l’écoulement d’un « courant de fuite ». Pour y remédier, le maître d’œuvre doit dimensionner les chaînes d’isolateurs en fonction de la classe de pollution du site, en utilisant une ligne de fuite spécifique minimale. Par exemple, une zone rurale requiert 16 mm/kV, tandis qu’une zone très polluante requiert 31 mm/kV.
4. Quelles sont les principales contraintes mécaniques considérées lors du dimensionnement d’une ligne aérienne ?
Le dimensionnement mécanique prend en compte les efforts permanents (poids propre, tension des câbles) et les efforts occasionnels. Les efforts occasionnels les plus importants sont engendrés par trois hypothèses climatiques majeures:
- L’Hypothèse de Tempête (A), dominée par la pression du vent.
- L’Hypothèse de Température Basse (B), pour les contraintes de traction par grand froid.
- L’Hypothèse de Givre, pour la surcharge due au poids de la glace.